Du 13 au 18 octobre, les Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont rassemblé à Washington ministres des finances, gouverneurs de banques centrales et experts internationaux. Au cœur des débats : la capacité des économies africaines francophones à maintenir la stabilité financière tout en réformant leur fiscalité pour financer le développement. Plusieurs délégations africaines francophones – du Sénégal à la Côte d’Ivoire, en passant par le Bénin et la RDC – étaient présentes pour défendre leurs priorités budgétaires et financières.
Par Olivia Yéré Daubrey, Envoyée Spéciale à Washington
D’emblée, le ton a été donné par Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI : « Nous traversons une période d’incertitude exceptionnelle et les risques baissiers dominent encore les perspectives ». « Restez vigilants et ne vous laissez pas aller à l’optimisme », a-t-elle ajouté, tout en soulignant une « résilience manifeste dans le monde ».
Selon les dernières Perspectives de l’économie mondiale, la croissance mondiale devrait ralentir légèrement cette année et l’an prochain, avec une moyenne autour de 3 % à moyen terme, bien en dessous des 3,7 % enregistrés avant la pandémie. Pour les pays africains francophones, déjà confrontés à une faible mobilisation fiscale et à des besoins sociaux pressants, ce climat de fragilité globale annonce des arbitrages difficiles.
« La croissance mondiale devrait ralentir légèrement cette année et l’an prochain, avec une moyenne autour de 3 % à moyen terme »

Les Signaux Mondiaux Vus de Washington
Le FMI et la Banque mondiale ont livré leur diagnostic sur l’économie mondiale. Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, a averti : « Les perspectives restent fragiles et très sensibles aux nouvelles sur le front commercial », ajoutant que dans un scénario de tensions accrues, cela « pourrait rapidement réduire la production mondiale d’environ 0,3 point de pourcentage ».
Pour l’Afrique subsaharienne, le ton est plus optimiste. Abebe Aemro Selassie, directeur Afrique du FMI, a rappelé : « La croissance économique de l’Afrique subsaharienne devrait se maintenir à 4,1 % en 2025, avec une reprise modeste attendue en 2026. Cela reflète les progrès continus en matière de stabilisation macroéconomique et d’efforts de réforme dans plusieurs économies clés ». Mais il souligne aussi les pressions persistantes : « La hausse du service de la dette évince les dépenses de développement, l’inflation reste à deux chiffres dans un cinquième de la région, et les réserves extérieures sont sous pression ».
Le Global Financial Stability Report du FMI confirme ces signaux d’alerte. Tobias Adrian, conseiller financier, résume : « Les conditions financières sont relativement faciles, mais les risques demeurent élevés ».
« Les conditions financières sont relativement faciles, mais les risques demeurent élevés »
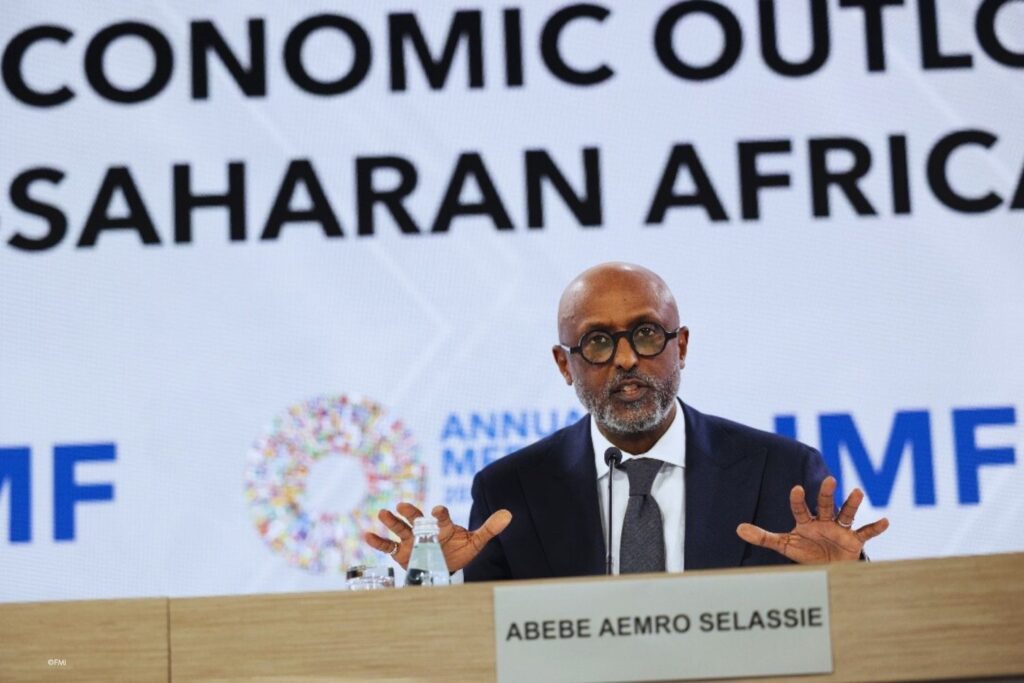
Afrique Francophone : Résilience Fragile
Pour l’Afrique francophone, le message est clair : la région garde une fenêtre d’opportunité, avec une croissance attendue à 4,1 % en 2025 (FMI) et 3,8 % (Banque mondiale). Mais ces chiffres masquent des fragilités profondes : pression fiscale faible, poids de l’informel, dépendance aux matières premières et faible digitalisation fiscale.
Interrogé par Forbes Afrique, Amadou Sy, directeur des recherches au département Afrique du FMI et rédacteur du SSA REO (Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa – « Perspectives économiques régionales pour l’Afrique subsaharienne »), insiste : « La dette publique s’est stabilisée, mais le vrai problème reste le poids du service de la dette, qui absorbe une grande part des budgets et limite les investissements nécessaires à la transition climatique ou à la digitalisation ». Selon lui, deux leviers s’imposent : « Renforcer la mobilisation des recettes fiscales et maintenir une croissance plus forte, malgré un contexte international incertain ».
« Le vrai problème reste le poids du service de la dette, qui absorbe une grande part des budgets et limite les investissements nécessaires à la transition climatique ou à la digitalisation »
Le Défi Fiscal et Budgétaire
La question fiscale reste le nerf de la guerre pour les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans l’espace UEMOA, l’objectif de 20 % du PIB en recettes fiscales demeure hors d’atteinte : la moyenne régionale plafonne autour de 15 %, loin des 34 % observés dans l’OCDE. Ce manque à gagner limite la capacité des États à financer infrastructures, protection sociale et transition climatique, tout en renforçant leur dépendance vis-à-vis des bailleurs internationaux.
« Dans l’espace UEMOA, l’objectif de 20 % du PIB en recettes fiscales demeure hors d’atteinte : la moyenne régionale plafonne autour de 15 %, loin des 34 % observés dans l’OCDE »
Pour la Côte d’Ivoire, engagée depuis 2023 dans un programme avec le FMI, les progrès sont visibles. « Les recettes fiscales sont passées de 12,7 % du PIB en 2022 à une estimation de 15 % en 2025, en bonne voie pour atteindre 15,7 % en 2026 », nous déclare ainsi Olaf Unteroberdoerster, chef de mission FMI pour Abidjan. Ces avancées reposent sur un impôt foncier modernisé, une fiscalité minière renforcée et la digitalisation accrue des procédures.
« Je me réjouis de cette avancée majeure qui illustre les ambitions du gouvernement en matière de transformation numérique », confie à Forbes Afrique Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement de Côte d’Ivoire. Elle ajoute : « La digitalisation est l’un des piliers du PND 2026-2030, car elle constitue un levier essentiel pour moderniser nos institutions et renforcer la compétitivité de notre économie. La Côte d’Ivoire franchit une étape décisive vers sa souveraineté numérique grâce à un financement de 100 millions de dollars accordé par l’Export-Import Bank des États-Unis. Grâce à nos efforts soutenus, la Côte d’Ivoire compte aujourd’hui 31 604 km de fibre optique, une couverture nationale en infrastructures TIC de 97 %, un taux de pénétration mobile passé de 75 % à 185 %, et une couverture 4G de 65,9 % en 2024 et qui passera à 100 % en 2030 ».
Le Sénégal affronte un dilemme similaire : répondre à des besoins sociaux pressants tout en gérant une dette publique élevée. Interrogé, Edward Gemayel, chef de mission FMI pour Dakar, prévient : « La consolidation budgétaire est inévitable, mais elle doit être saine et ne pas pénaliser les populations vulnérables. Réduire certaines exonérations fiscales, notamment celles accordées depuis longtemps à de grandes entreprises, pourrait dégager jusqu’à 7 à 8 % du PIB ». Dans ce contexte, la protection des programmes sociaux comme le RNU (Registre National Unique, base de données servant à la sélection des bénéficiaires des programmes de protection sociale), qui couvre déjà près d’un quart de la population, reste cruciale.

Faire Face à l’Informalité
Au-delà des chiffres, la structure des économies constitue un frein majeur : dans de nombreux pays francophones, plus de la moitié de l’activité reste informelle. « L’informalité peut prendre de nombreuses formes », observe Era Dabla-Norris, directrice adjointe du département des finances publiques du FMI. « Pour y répondre, les pays africains déploient des stratégies comme l’adoption d’outils numériques (paiement mobile, enregistrement électronique) ou des procédures simplifiées pour aider les petits entrepreneurs ».
La digitalisation est ainsi devenue un levier clé. Davide Furceri, chef de division au FMI, rappelle : « Dans de nombreux pays, y compris en Afrique, la digitalisation a été adoptée pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales ». Dans cette dynamique, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a lancé un système d’interopérabilité en temps réel entre banques, institutions de microfinance et opérateurs de mobile money. « C’est une avancée majeure en termes d’infrastructure, même si le taux d’adoption reste à suivre », souligne Amadou Sy, co-rédacteur du rapport régional du FMI.
« Dans de nombreux pays, y compris en Afrique, la digitalisation a été adoptée pour renforcer la mobilisation des recettes fiscales »
Mais la technique ne suffira pas. « La modernisation des systèmes fiscaux par la digitalisation, la rationalisation des dépenses fiscales inefficaces et le renforcement de la conformité sont des priorités. Mais au-delà des aspects techniques, il sera essentiel de renforcer la confiance du public », insiste Abebe Selassie, directeur Afrique du FMI.
« Au-delà des aspects techniques, il sera essentiel de renforcer la confiance du public »
Un constat partagé par le Caucus africain – organe qui réunit chaque année les ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales africains pour porter une voix commune auprès du FMI et de la Banque mondiale. Présidé cette année par le ministre centrafricain Hervé Ndoba, le Caucus a rappelé que « le renforcement de la mobilisation des ressources domestiques reste une priorité centrale », appuyée par la digitalisation et l’élargissement de l’assiette fiscale. Il appelle également à un meilleur accès aux financements concessionnels et climatiques, face à des besoins évalués à plusieurs points de PIB par an.
« Le renforcement de la mobilisation des ressources domestiques reste une priorité centrale », appuyée par la digitalisation et l’élargissement de l’assiette fiscale.
Enfin, certains pays commencent à élargir le spectre des réformes. En Côte d’Ivoire, Olaf Unteroberdoerster met en avant une innovation majeure : « Pour la première fois, le budget 2026 inclura une déclaration des risques climatiques, identifiant les impacts potentiels sur les finances publiques ». De son côté, le Bénin s’impose comme modèle régional en digitalisant rapidement sa collecte fiscale et en modernisant la fiscalité foncière. « Garder le cap, année après année, comme l’ont montré le Bénin, la Côte d’Ivoire ou le Rwanda, est essentiel pour élargir l’assiette et atteindre les objectifs », insiste Abdoulaye Sy.
« En Côte d’Ivoire, « pour la première fois, le budget 2026 inclura une déclaration des risques climatiques, identifiant les impacts potentiels sur les finances publiques » ».
D’autres leviers restent essentiels, résumés en ces termes par César Calderon, économiste principal région Afrique à la Banque mondiale, dans un entretien à Forbes Afrique : « Les infrastructures sont l’épine dorsale du développement économique. Or, de nombreux pays d’Afrique francophone accusent encore un retard considérable dans l’énergie, le numérique, les transports et l’eau. Sans combler ce déficit, le secteur privé ne pourra pleinement jouer son rôle et la transformation structurelle restera incomplète ».


Les Priorités Africaines à l’Agenda du FMI et de la Banque Mondiale
Au-delà des équilibres macroéconomiques, les Assemblées annuelles ont mis en avant des priorités sectorielles décisives pour l’Afrique francophone. Deux instruments ressortent particulièrement : le Poverty Reduction and Growth Trust1 (PRGT), qui permet au FMI de fournir des prêts hautement concessionnels – notamment à taux zéro dans certains cas – aux pays à faible revenu, et le Resilience and Sustainability Trust2 (RST), conçu pour soutenir les pays vulnérables dans leur transition climatique, leur résilience structurelle et le renforcement de la stabilité extérieure. Selon le FMI, les engagements annuels du PRGT devraient atteindre 7,1 milliards de dollars par an, tandis que 26 programmes RST ont déjà été approuvés, dont près de la moitié en Afrique.
« Selon le FMI, les engagements annuels du PRGT devraient atteindre 7,1 milliards de dollars par an, tandis que 26 programmes RST ont déjà été approuvés, dont près de la moitié en Afrique »
Pour les pays francophones, ces guichets représentent une opportunité stratégique. Olaf Unteroberdoerster, chef de mission pour la Côte d’Ivoire, insiste : « La Côte d’Ivoire est pionnière dans l’utilisation du RST, avec l’intégration d’une taxonomie verte et la publication prochaine d’un budget sensible au climat ». Un signal fort, à l’heure où les chocs climatiques amputent chaque année 1 à 2 points de PIB dans les économies les plus vulnérables, selon les estimations du FMI.
« La Côte d’Ivoire est pionnière dans l’utilisation du RST, avec l’intégration d’une taxonomie verte et la publication prochaine d’un budget sensible au climat »
Enfin, l’inclusion sociale reste une ligne rouge. Les institutions rappellent que la consolidation budgétaire ne doit pas se traduire par une contraction des dépenses essentielles. Edward Gemayel, chef de mission FMI pour le Sénégal, insiste : « La consolidation budgétaire est inévitable, mais elle doit être saine et ne pas pénaliser les populations vulnérables ». Un équilibre difficile, alors que près de 15 % des recettes publiques de certains pays sont déjà absorbées par le service de la dette, selon le Caucus africain.
« La consolidation budgétaire est inévitable, mais elle doit être saine et ne pas pénaliser les populations vulnérables »
Justice Tei Mensah, économiste senior à la Banque mondiale, souligne pour sa part l’importance de la diversification économique : « Les économies riches en ressources restent très vulnérables aux chocs de prix des matières premières. Il est crucial de réinvestir les revenus des secteurs extractifs dans l’éducation, la santé et les infrastructures pour stimuler la croissance d’autres secteurs et bâtir une véritable résilience ».
Au terme de ces Assemblées, un constat s’impose : l’Afrique francophone avance sur une ligne de crête. Entre les exigences de rigueur budgétaire, les besoins massifs d’investissement social et climatique, et la fragilité d’un contexte mondial marqué par l’incertitude, chaque choix devient stratégique. La question reste ouverte : l’Afrique francophone saura-t-elle transformer cette résilience statistique en un véritable développement durable et inclusif ?
« Entre les exigences de rigueur budgétaire, les besoins massifs d’investissement social et climatique, et la fragilité d’un contexte mondial marqué par l’incertitude, chaque choix devient stratégique »
Séance plénière des Assembles annuelles 2025 en replay Ici
1. Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance
Lire Aussi :





